Appuyez sur ESC pour fermer
Ou consultez nos catégories populaires..., résumé du supplément au voyage de bougainville de diderot.
Supplément au voyage de Bougainville : le mode de vie des Tahitiens comme modèle des Lumières
Nous vous proposons ici un voyage vers des contrées caressées par les alizés avec l’esprit critique de Denis Diderot (1713-1784). En effet, dans ce Résumé de Supplément au voyage de Bougainville, vous découvrirez que le philosophe des lumières est critique quant à ce qu’il a pu lire du Voyage autour du monde de l’explorateur et navigateur français Louis-Antoine de Bougainville (1729-1811), paru en 1771. Ce journal de bord relate la circumnavigation de Bougainville entre 1766 et 1769.
Dans son Supplément au voyage de Bougainville, Denis Diderot met en scène deux protagonistes nommés A et B. B souhaite présenter un soi-disant supplément au récit de Bougainville remettant en question certains faits. Cinq chapitres développent cet argumentaire.
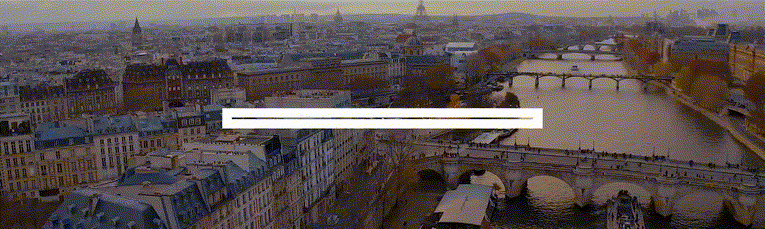
Chapitre 1: Amorce du récit et considérations générales sur le voyage de Bougainville
Dans ce premier chapitre du Supplément au voyage de Bougainville, les deux personnages attendent que le brouillard disparaisse afin de pouvoir continuer leur cheminement. Dans cette attente, B lit le Voyage autour du monde du célèbre navigateur ainsi qu’un soit-disant supplément à ce récit. A n’a jamais lu ledit ouvrage et questionne son compagnon sur la nature de l’auteur. B résume ainsi les grandes étapes de ce périple autour du monde.
B aborde les difficultés rencontrées par les deux navires de l’expédition : La Boudeuse et L’Etoile : lutte contre les éléments naturels, avaries, maladies, rationnement, etc. La navigation n’était pas chose aisée même au Siècle des Lumières.
Puis B évoque certains faits relatés dans divers autres récits de voyage : l’expansionnisme colonial des Jésuites du Paraguay et leur expulsion, la rumeur des géants vivants en Patagonie, la sagesse et la qualité de vie des habitants des îles du Pacifique ou encore l’histoire du Tahitien, Aotourou, qui accompagna Bougainville jusqu’en métropole. A démontre un vif intérêt pour ce Supplément au voyage de Bougainville. B l’encourage alors dans la lecture de ce récit complémentaire.
Dans le chapitre suivant, notre Résumé de Supplément au voyage de Bougainville présente un supposé extrait du Supplément dont B faisait l’éloge à A.
Chapitre 2 : L’hostilité du vieux Tahitien à l’encontre de Bougainville
Dans la suite du Supplément au voyage de Bougainville, Denis Diderot donne la réplique à un vieillard indigène qui reproche aux habitants de l’île d’être tristes du départ des Français. En tant que figure de sagesse, les propos du vieillard sont forts. Il considère les voyageurs comme des envahisseurs. Leur visite ne doit pas être un sujet de joie mais d’inquiétude. Quand ils reviendront, ils corrompront son peuple avec leurs mœurs divergentes et mauvaises.
Dans ce passage du Supplément au voyage de Bougainville, le vieillard s’adresse directement à Bougainville qu’il nomme « chef des brigands ». L’influence de son équipage est mauvaise pour les Tahitiens. Le bonheur « édénique » de ces derniers est troublé.
Le lecteur est littéralement plongé dans un réquisitoire pour défendre la vie sauvage des insulaires face à la prétendue civilisation européenne. Le vieux Tahitien va jusqu’à souhaiter la mort de Bougainville et de son équipage sur le chemin du retour. Ainsi garderont-ils secrète la découverte de Tahiti.
Dans son Supplément au voyage de Bougainville, Denis Diderot affirme que Bougainville a vraiment vécu cette entrevue avec le vieux Tahitien mais qu’il n’a pas voulu la retranscrire en raison de son hostilité.
Dans la suite de notre Résumé de Supplément au voyage de Bougainville, nous verrons que Diderot offre à son lecteur un prétendu passage du Supplément que lit B.
Chapitres 3 et 4 du livre de Diderot : l’entretien entre un Tahitien et un jésuite
Deux personnages sont introduits. Orou, un hôte âgé d’une trentaine d’années qui est marié et père de trois filles. Un aumônier jésuite du même âge qu’Orou. Un fait étonnant mais établi dans les mœurs tahitiennes, l’hôte offre une de ses quatre épouses à l’aumônier pour la nuit. L’Occidental refuse au nom de sa religion. Une conversation s’amorce entre les deux hommes. Orou souhaite que le religieux s’accommode des mœurs tahitiennes.
Le jésuite cède et passe la nuit avec la plus jeune des filles d’Orou, qui se nomme Thia. Un siècle plus tard, le peintre Paul Gauguin (1848-1903) n’aura pas à se faire prier pour passer des moments voluptueux avec de jeunes tahitiennes.
Au matin suivant, Orou souhaite savoir ce que signifie « la religion ». Un discours théologique s’amorce alors dans ce Supplément au voyage de Bougainville . Le Jésuite devise sur la conception chrétienne du cosmos. Tout ce qui existe est l’œuvre de Dieu, le Tout-Puissant. Il est éternel et insaisissable. La question du Bien et du Mal est posée. Le religieux présente le Dieu chrétien enfermé dans un rôle moralisateur.
C’est lui qui dicte ce qui est bon et mauvais pour l’homme. Pour Orou, cette vision est inconcevable. Il démontre au jésuite que sa vision d’un Dieu moralisateur n’est ni conforme à la Nature, ni à la Raison. Denis Diderot expose là une problématique chère aux philosophes des Lumières. Pour Orou, les lois qui régissent la civilisation occidentale n’ont aucun sens. Les injonctions morales, sociales et juridiques ne signifient rien.
Continuons notre Résumé de Supplément au voyage de Bougainville en abordant le point du de vue d’Orou sur bien des sujets qui opposent la civilisation européenne et la civilisation polynésienne. Selon le Tahitien, dans une union, le culte de la maternité prévaut. La richesse d’une communauté réside dans les enfants. Enfin, l’importance des rituels est primordiale pour la cohésion du groupe.
Le Résumé de Supplément au voyage de Bougainville se poursuit avec le chapitre 4 qui est une continuité de l’entretien entre Orou et le jésuite. Ce dernier a du mal à saisir la notion de libertinage amoureux tant répandu chez les Tahitiens. En effet, pour les insulaires la procréation est au centre de tous les rituels de la communauté.
Les transgresser, c’est « tabou », pour reprendre le terme exacte qui est développé longuement par Herman Melville dans son ouvrage Taïpi (1846). Ce récit autobiographique se déroule sur une des îles de l’archipel des Marquises. Diderot profite de cet échange pour fustiger les vœux de chasteté du clergé catholique. Ce vœu est contraire à la nature et donc à la raison.
Dans la suite de notre Résumé de Supplément au voyage de Bougainville, nous reprendrons le dialogue entre nos deux protagonistes d’origine, A et B.
Chapitre 5 : Suite et fin du dialogue entre A et B
A et B continuent d’échanger à propos des mœurs tahitiennes. Bien entendu, ils les approuvent. Denis Diderot leur fait dire que la civilisation occidentale a asservi les hommes avec des lois artificielles et contraires à la nature.
Pour le philosophe des Lumières, les sociétés européennes ont tort de ne pas vouloir laisser les hommes vivre selon les lois de la nature. La morale et la religion sont présentées comme les sources du malheur de l’Européen. Il a perdu sa nature édénique, pourrait-on dire.
Pourquoi lire ce commentaire composé ?
Catégorisé:
Étiqueté dans :
Partager l'article :
Articles Liés
Résumé du barbier de séville de beaumarchais, résumé de l’immoraliste de andré gide, résumé de lolita de vladimir nabokov, résumé de l’éducation sentimentale de gustave flaubert, autres histoires, etude des personnages dans le tartuffe ou l’imposteur de molière, résumé de stupeur et tremblements d’amélie nothomb.
Denis Diderot
Oral du bac de français, ecrit du bac de français, pour aller plus loin.

01 86 76 13 95
(Appel gratuit)
Supplément au voyage de Bougainville, Denis Diderot
Ce dialogue philosophique n’a été publié qu’après la mort de Diderot et se présente, ainsi que l’indique son titre, comme une suite au Voyage autour du monde écrit par l’explorateur Bougainville. Ce Voyage , paru en 1771, décrit les contrées lointaines encore inconnues des Européens. Son analyse de la société tahitienne, si différente du vieux monde, avait frappé ses contemporains. La découverte de nouvelles civilisations et de nouvelles cultures est le point de départ de la réflexion morale de Diderot.
Le Supplément est un dialogue entre deux personnages, A et B. On retrouve ici la forme du dialogue, que Diderot avait déjà expérimenté dans Le Neveu de Rameau , et qui permet d’allier une écriture rapide et légère à une réflexion philosophique.
B : Lecteur de Bougainville. A : Ami de B auquel il raconte le voyage de Bougainville. Orou : Sage otaïtien, porteur d’une tradition, il est conscient des dangers que représentent les Européens pour sa civilisation. L’aumônier : Religieux européen, il est fait de contradictions qui trouveront peut-être leur résolution en Otaïti.
L’opposition entre deux sociétés : Le grand intérêt de ce texte est de proposer une comparaison entre la société dite civilisée et une société prétendument sauvage. Diderot reprend une réflexion entamée par Montaigne qui renverse la hiérarchie des valeurs proposée par l’Occident. Grâce au déplacement du voyage, ce n’est plus l’otaïtien qui représente la nouveauté curieuse et intrigante, mais au contraire l’européen, sous les traits de l’aumônier qui est une source d’étonnement pour les autochtones. Grâce à ce déplacement, la société dans laquelle vit le lecteur et qui lui a probablement toujours semblé aller de soi lui apparaît sous un angle nouveau et étranger. Sont alors pointées les incohérences et les contradictions des civilisations européennes. La morale et la politique : Au-delà de ce comparatisme culturel, Diderot élabore une réflexion philosophique portant sur la morale et sur la politique. L’une des grandes questions soulevées par ce texte porte sur l’étendue de la morale : est-elle relative ou universelle ? Le bien et le mal sont-ils des valeurs purement culturelles ? Il cherche également ce qui constitue le fondement d’une société et sur quelles lois naturelles s’ancre une communauté politique. Le dialogue : La forme de ce dialogue est aussi riche que la réflexion qu’elle porte. Les deux interlocuteurs du début laissent place à deux autres personnages, l’aumônier et Orou, dans un jeu de récits enchâssés et croisés. Ce double jeu de dialogue relance l’autre dialogue, celui que Diderot tisse avec le livre de Bougainville.
Chapitre I - Jugement du voyage de Bougainville
Au cours d’une discussion, A et B évoquent le livre de Bougainville que B est en train de lire. A n’a pas lu cet ouvrage que B lui décrit. Il raconte ainsi le voyage de Bougainville, il parle d’Aotourou, un otaïtien qui accompagna Bougainville jusqu’à Paris, et de la « vie sauvage » des Otaïtiens que B compare aux mœurs européennes, si différentes.
B propose ensuite à A de lire un passage du Voyage concernant l’adieu que fit le chef d’une île aux voyageurs.
Chapitre II - Les adieux du vieillard
À l’arrivée des Européens, ce vieillard s’était enfermé chez lui. Lorsque ceux-ci s’en vont, le vieillard tient un discours dans lequel il déclare qu’il faut se lamenter lorsqu’ils arrivent et non lorsqu’ils partent. Il reproche à Bougainville d’avoir introduit les vices européens chez eux, dévalorise la prétendue civilisation européenne et souhaite aux navires de couler.
Chapitre III - Entretien de l’aumônier et d’Orou
L’otaïtien Orou loge un aumônier. Après le repas, Orou propose à l’aumônier de choisir entre sa femme et ses trois filles afin que l’une d’entre elles devienne mère. L’aumônier refuse à cause de sa religion. S’en suit une discussion sur les rapports entre les hommes et les femmes dans la société otaïtienne, ainsi que sur la religion. Orou ne comprend pas les Européens, qui sont censés obéir à l’État et à Dieu, mais qui ne sont pas punis lorsqu’ils ne le font pas.
La conversation retourne à A et B qui parlent de miss Polly Baker, une femme qui a été de nombreuses fois enceinte sans être mariée. Elle a échappé à la punition prévue en renvoyant la culpabilité sur les hommes.
Chapitre IV - Suite de l’entretien de l’aumônier et d’Orou
L’aumônier et Orou poursuivent la comparaison de leurs cultures respectives. Il est notamment question d’inceste, d’adultère, de l’importance des enfants, de l’argent, des religieux. Orou ne comprend pas les obligations qui lient les moines.
L’aumônier finit par céder à la tentation que représentent les filles et la femme d’Orou.
Chapitre V - Suite du dialogue entre A et B
À leur tour, A et B comparent les sociétés d’Europe et d’Otaïti. Ils se rendent compte que beaucoup des principes auxquels ils tiennent ne sont pas naturels mais acquis. Il leur semble que l’homme sauvage est davantage dans le juste que l’homme civilisé : il faudrait en effet se rapprocher davantage des lois de la nature.
« A – Cette superbe voûte étoilée sous laquelle nous revînmes hier et qui semblait nous garantir un beau jour, ne nous a pas tenu parole. B – Qu’en savez-vous ? A – Le brouillard est si épais qu’il nous dérobe la vue des arbres voisins. B – Il est vrai ; mais si ce brouillard qui ne reste dans la partie inférieure de l’atmosphère que parce qu’elle est suffisamment chargée d’humidité, retombe sur la terre ? A – Mais si au contraire il traverse l’éponge, s’élève et gagne la région supérieure où l’air est moins dense et peut, comme disent les chimistes, n’être pas saturé ? B – Il faut attendre. A – En attendant, que faites-vous ? B – Je lis. A – Toujours ce voyage de Bougainville ? B – Toujours. » « OROU – Mais dis-moi donc pourquoi tu n’es pas vêtu comme les autres ? Que signifie cette casaque longue qui t’enveloppe de la tête aux pieds et ce sac pointu que tu laisses tomber sur tes épaules ou que tu ramènes sur tes oreilles ? L’AUMÔNIER – C’est quel tel que tu me vois, je me suis engagé dans une société d’hommes qu’on appelle dans mon pays des moines. Le plus sacré de leurs vœux est de n’approcher d’aucune femme et de ne point faire d’enfants. OROU – Que faites-vous donc ? L’AUMÔNIER – Rien. OROU – Et ton magistrat souffre cette espèce de paresseux, la pire de toutes ? L’AUMÔNIER – Il fait plus, il la respecte et la fait respecter. » « Veux-tu savoir en tout temps et en tout lieu ce qui est bon et mauvais ? Attache-toi à la nature des choses et des actions, à tes rapports avec ton semblable, à l’influence de ta conduite sur ton utilité particulière et le bien général. » « Je ne sais quels sont ces personnages que tu appelles magistrats et prêtres, dont l’autorité règle votre conduite ; mais, dis-moi, sont-ils maîtres du bien et du mal ? Peuvent-ils faire que ce qui est juste soit injuste, et que ce qui est injuste soit juste ? Dépend-il d’eux d’attacher le bien à des actions nuisibles et le mal à des actions innocentes ou utiles ? Tu ne saurais le penser, car à ce compte il n’y aurait ni vrai ni faux, ni bon ni mauvais, ni beau ni laid, du moins que ce qu’il plairait à ton grand ouvrier, à tes magistrats, à tes prêtres. »
- Profil d'œuvre : Supplément au voyage de Bougainville
Supplément au voyage de Bougainville Profil d'œuvre
Supplément au voyage de Bougainville
Denis Diderot
Supplément au voyage de Bougainville de Diderot est un dialogue opposant deux façons de penser, de vivre. Les thèmes principaux sont le colonialisme et la vie sauvage. L'auteur compare l'homme civilisé orgueilleux et l'homme naturel libre. C'est quelques années après sa visite à Catherine II de Russie que Diderot écrit cet ouvrage. Il ne croit plus au despote éclairé. Le Supplément au voyage de Bougainville se veut une réponse fictive au récit de voyage de l'explorateur Bougainville qui avait découvert l'Océanie. Dans ce texte, Diderot donne la parole aux victimes de la colonisation. Ce sont ici les tahitiens. L'auteur inverse les regards pour dénoncer l'injustice. Il peut ainsi critiquer les sociétés occidentales. Ce long dialogue est perçu comme un réquisitoire critiquant Bougainville et, plus largement, l'Occident. Il fait aussi l'éloge de la vie sauvage, Diderot utilisant ainsi le mythe du bon sauvage inventé au siècle des Lumières.
Un réquisitoire
Le discours du tahitien, héros de l'ouvrage, est divisé en deux parties. La première partie est un réquisitoire critiquant Bougainville et la société occidentale. Diderot énumère les fautes de Bougainville et y oppose les mœurs des tahitiens. L'idée est développée que le mode de vie tahitien est meilleur que celui des européens. Les civilisés ne sont pas ceux que l'on croit. Les Occidentaux paraissent absurdes. La deuxième partie du texte sert de conclusion au discours du tahitien. Il résume tout ce qu'il a dit avant. Il demande à Bougainville et ses hommes de quitter Tahiti. Les moeurs des tahitiens ne sont pas moins bonnes que celles des européens. Elles sont différentes. Les Occidentaux apparaissent ici comme des sauvages.
Une critique de la société occidentale
La violence.
Chez les tahitiens, les femmes sont libres. Elles peuvent être avec la personne de leur choix. Bougainville en a profité, mais ensuite il demande aux femmes tahitiennes de respecter "sa" morale, et de n'être qu'avec un homme, comme en Europe. C'est alors que commence la violence, motivée par la jalousie. Sous couvert de morale, les Occidentaux ont apporté la haine.
Tu es venu allumer en elles des fureurs inconnues. Elles sont devenues folles dans tes bras, tu es devenu féroce entre les leurs. Elles ont commencé à se haïr, vous vous êtes égorgés pour elles; et elles nous sont revenues teintes de votre sang.
La propriété et l'esclavage
La notion de propriété a été introduite par les Occidentaux. Ce concept créé alors le concept même de vol. On ne peut voler que ce qui appartient à un autre. Bougainville applique sa vision des choses aux tahitiens. Il punit sévèrement le vol, alors que les tahitiens ne voient pas le mal à prendre quelque chose qui n'appartient à personne. Il fait aussi des tahitiens des esclaves. Il assujettit une population et s'approprie ses terres. Il veut dominer. Il parle de propriété mais finalement n'imagine pas une seconde qu'il prend la terre d'hommes qui vivaient là avant lui. Tout tourne autour des occidentaux, de leurs moeurs, de leurs idées.
Le "sauvage"
Diderot souligne plusieurs fois l'ethnocentrisme occidental. On comprend bien mieux pourquoi les tahitiens rejettent les coutumes européennes, puisqu'elles les oppriment. Ce qui paraît civilisé ne l'est plus. Les Occidentaux deviennent des sauvages. En effet, ils qualifient les tahitiens de sauvages mais ce sont eux qui sont barbares en instaurant l'esclavage. Ceux qui détiennent le savoir semblent être les tahitiens, qui sont plus sages, moins violents. C'est Diderot qui s'exprime à travers le narrateur tahitien, qui est un vieil homme. Son âge souligne sa sagesse.
L'éloge de la société tahïtienne
Diderot fait l'éloge de la société tahitienne, qui devient une société idéale. Ce peuple possède un mode de vie simple. Les choses essentielles pour les tahitiens sont le bonheur, l'innocence et la tranquillité. C'est la nature qui prime ici. La nature est synonyme de bien, de bonté. C'est le mythe du "bon sauvage". Les philosophes des Lumières pensent qu'une société qui reviendrait à la nature serait plus saine, plus juste. L'équilibre et la pureté de la culture tahitienne tiennent à son innocence et sa liberté. Elle n'est pas victime des carcans occidentaux.
Vous êtes deux enfants de la nature ; quel droit as-tu sur lui qu'il n'ait pas sur toi ? Tu es venu ; nous sommes-nous jetés sur ta personne ? avons-nous pillé ton vaisseau ? t'avons-nous saisi et exposé aux flèches de nos ennemis ? t'avons-nous associé dans nos champs au travail de nos animaux ? Nous avons respecté notre image en toi. Laisse nous nos mœurs ; elles sont plus sages et plus honnêtes que les tiennes ; nous ne voulons point troquer ce que tu appelles notre ignorance, contre tes inutiles lumières. Tout ce qui nous est nécessaire et bon, nous le possédons.
Formulaire de recherche

Supplément au voyage de Bougainville Diderot, 1772
Le Supplément se présente comme un dialogue sur le récit, publié par Bougainville, de son voyage autour du monde et de son séjour à Tahiti, surnommé la Nouvelle Cythère, car les amours y seraient libres. Le décor est exotique mais le propos de Diderot radical. Un dialogue s'ouvre au second degré entre les Tahitiens et les Européens. Les Tahitiens n'ont pas de difficulté à prouver la supériorité de leur code par rapport aux contradictions et aux interdits européens. Ils incarnent une nature, mythique sans doute, qui permet à Diderot de faire la critique de la société chrétienne. Les plus lucides d'entre eux dénoncent le colonialisme à venir. Ces dialogues ne remplacent pas un traité, ils illustrent la complexité de la question morale. En offrant la possibilité de rencontrer les Tahitiens, ces hommes du commencement des temps, Le Supplément au voyage de Bougainville questionne la relation entre nature et culture.

- Malheureux Taïtiens
- Forfaits de Bougainville
- L’aumônier et Orou
- Toutes les éditions
- Voyage autour du monde

SUPPLÉMENT AU VOYAGE DE BOUGAINVILLE, Denis Diderot Fiche de lecture
- 1. Une œuvre polyphonique
- 2. Une utopie critique
- 3. Bibliographie
La genèse et l' édition des œuvres de Diderot (1713-1784) sont souvent complexes et problématiques : comme le Paradoxe sur le comédien (conçu en 1769, publié en 1830), le Supplément au Voyage de Bougainville n'est à l' origine qu'un compte rendu de lecture destiné à La Correspondance littéraire de Grimm : une note sur le Voyage autour du monde (1771) que Bougainville rédigea à partir du Journal tenu lors de son voyage à Tahiti (6-15 avril 1768). Si dans un premier temps Grimm ne publie pas le texte de Diderot, une version remaniée du Supplément au Voyage de Bougainville paraît en feuilleton dans La Correspondance littéraire , en 1773 et 1774 ; mais la première édition en est posthume (1796), et il existe plusieurs versions manuscrites du texte, dont on publie désormais la plus longue. Inséparable de deux autres textes parus en 1798 dans un ordre concerté ( Ceci n'est pas un conte et Madame de la Carlière ), le Supplément au Voyage de Bougainville témoigne bien de la dimension de « création continuée » qui caractérise la pensée de Diderot. Elle va de pair avec le refus de tout dogmatisme et de toute réponse arrêtée dans la question centrale qui occupe le siècle des Lumières : celle de l'état de nature et de l'usage critique de cette notion.
Une œuvre polyphonique
Le Supplément au Voyage de Bougainville fait entendre plusieurs voix : les deux interlocuteurs, A et B, commentent, texte à l'appui, ce Voyage que B est en train de lire, et dont il prétend restituer l'intégralité, car les passages licencieux en auraient été supprimés. Cette fiction justifie le « supplément », terme défini par le Dictionnaire de Trévoux comme « ce qu'on ajoute à un auteur, pour remplir les lacunes qui se trouvaient dans ses ouvrages ». Suppléer consiste ici, pour Diderot, à commenter le Voyage de Bougainville sans laisser la parole à l'explorateur lui-même.
La version longue du texte comporte cinq parties, dont la première et la dernière, respectivement « Jugement du Voyage de Bougainville » et « Suite du dialogue entre A et B », encadrent d'autres discours rapportés : la prosopopée d'un vieux Tahitien (« Les Adieux du vieillard »), l'« Entretien de l'aumônier et d'Orou » (III) qui contient, en un nouvel enchâssement, l'histoire de Polly Baker et sa défense devant les juges rapportée au discours direct, enfin la suite de l'entretien de l'aumônier et d'Orou dans la section IV, non titrée. Pluralité des voix, mais aussi intertextualité assumée, voire exhibée par une activation du « principe dialogique » théorisé par Mikhaïl Bakhtine. Le Supplément fait aussi écho aux Dialogues de La Hontan avec un « sauvage de bon sens qui a voyagé » (1703), ou reprend l'histoire de Polly Baker à l' Histoire des deux Indes (1770), de l'abbé Raynal, à laquelle Diderot a contribué. Participent également de cette polyphonie le glissement d'un plan de l'énonciation à un autre, comme lorsque A s'adresse fictivement à Aotourou, le Tahitien que Bougainville a ramené en France et promené dans les salons parisiens : « O Aotourou, que tu seras content de revoir ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, tes compatriotes ! Que leur diras-tu de nous ? ». Mêlant lyrisme et ironie, Diderot met en scène un débat philosophique, dont les termes sont clairement résumés par A au terme du dialogue : « Reviendrons-nous à la nature ? Nous soumettrons-nous aux lois ? » B donne sa réponse, celle d'une adaptation à un état de fait – « Prendre le froc du pays où l'on va, et garder celui du pays où l'on est » – qui, si elle n'est pas sans évoquer la fin du Paradoxe sur le comédien et sa morale courtisane, n'est peut-être pas exactement celle de Diderot.
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Découvrez nos offres
Déjà abonné ? Se connecter
- Anouchka VASAK : ancienne élève de l'École normale supérieure de Fontenay-aux-Roses, maître de conférences à l'université de Poitiers
Carte mentale Élargissez votre recherche dans Universalis
Classification
Pour citer cet article
- APA (7 ème version)
- Chicago Style
Anouchka VASAK. SUPPLÉMENT AU VOYAGE DE BOUGAINVILLE, Denis Diderot - Fiche de lecture [en ligne]. In Encyclopædia Universalis . Disponible sur : (consulté le )
VASAK, A.. SUPPLÉMENT AU VOYAGE DE BOUGAINVILLE, Denis Diderot - Fiche de lecture . Encyclopædia Universalis . (consulté le )
VASAK, Anouchka. « SUPPLÉMENT AU VOYAGE DE BOUGAINVILLE, Denis Diderot - Fiche de lecture ». Encyclopædia Universalis . Consulté le .
VASAK, Anouchka. « SUPPLÉMENT AU VOYAGE DE BOUGAINVILLE, Denis Diderot - Fiche de lecture ». Encyclopædia Universalis [en ligne], (consulté le )
Autres références
CULTURE - Nature et culture
- Écrit par Françoise ARMENGAUD
RÉCIT DE VOYAGE
- Écrit par Jean ROUDAUT
FRANÇAISE LITTÉRATURE, XVIII e s.
- Écrit par Pierre FRANTZ
- LES LETTRES PERSANES, Montesquieu - Le regard éloigné
- NATURE ÉTAT DE

Rejoignez-nous
Inscrivez-vous à notre newsletter
Accédez à l'intégralité d'Universalis.fr sans publicité
- Liste des auteurs
- Contexte historique
- Recherche thématique
- L’entremetteur littéraire
Supplément au voyage de Bougainville
Bougainville boucle le premier tour du monde français en 1769, et publie son journal de bord en 1771. Comme Montaigne deux siècles auparavant, les philosophes sont frappés par ce récit et Diderot ne tarde pas à réagir, en critiquant la société de son temps à partir des vertus supposées des Taïtiens.
Au départ de Bougainville, lorsque les habitants accouraient en foule sur le rivage, s’attachaient à ses vêtements, serraient ses camarades entre leurs bras, et pleuraient, ce vieillard s’avança d’un air sévère, et dit :
« Pleurez, malheureux Taïtiens ! Pleurez ; mais que ce soit de l’arrivée, et non du départ de ces hommes ambitieux et méchants : un jour, vous les connaîtrez mieux. Un jour, ils reviendront, le morceau de bois que vous voyez attaché à la ceinture de celui-ci, dans une main, et le fer qui pend au côté de celui-là, dans l’autre, vous enchaîner, vous égorger, ou vous assujettir à leurs extravagances et à leurs vices ; un jour vous servirez sous eux, aussi corrompus, aussi vils, aussi malheureux qu’eux. Mais je me console ; je touche à la fin de ma carrière ; et la calamité que je vous annonce, je ne la verrai point. Taïtiens ! Mes amis ! Vous auriez un moyen d’échapper à un funeste avenir ; mais j’aimerais mieux mourir que de vous en donner le conseil. Qu’ils s’éloignent, et qu’ils vivent. »
Puis s’adressant à Bougainville, il ajouta : « Et toi, chef des brigands qui t’obéissent, écarte promptement ton vaisseau de notre rive : nous sommes innocents, nous sommes heureux ; et tu ne peux que nuire à notre bonheur. Nous suivons le pur instinct de la nature ; et tu as tenté d’effacer de nos âmes son caractère. Ici tout est à tous ; et tu nous as prêché je ne sais quelle distinction du tien et du mien . Nos filles et nos femmes nous sont communes ; tu as partagé ce privilège avec nous ; et tu es venu allumer en elles des fureurs inconnues. Elles sont devenues folles dans tes bras ; tu es devenu féroce entre les leurs. Elles ont commencé à se haïr ; vous vous êtes égorgés pour elles ; et elles nous sont revenues teintes de votre sang. Nous sommes libres ; et voilà que tu as enfoui dans notre terre le titre de notre futur esclavage. Tu n’es ni un dieu, ni un démon : qui es-tu donc, pour faire des esclaves ? Orou ! Toi qui entends la langue de ces hommes-là, dis-nous à tous, comme tu me l’as dit à moi, ce qu’ils ont écrit sur cette lame de métal : Ce pays est à nous . Ce pays est à toi ! et pourquoi ? Parce que tu y as mis le pied ? Si un Taïtien débarquait un jour sur vos côtes, et qu’il gravât sur une de vos pierres ou sur l’écorce d’un de vos arbres : Ce pays appartient aux habitants de Taïti , qu’en penserais-tu ? Tu es le plus fort ! Et qu’est-ce que cela fait ? Lorsqu’on t’a enlevé une des méprisables bagatelles dont ton bâtiment est rempli, tu t’es récrié, tu t’es vengé ; et dans le même instant tu as projeté au fond de ton cœur le vol de toute une contrée ! Tu n’es pas esclave : tu souffrirais la mort plutôt que de l’être, et tu veux nous asservir ! Tu crois donc que le Taïtien ne sait pas défendre sa liberté et mourir ? Celui dont tu veux t’emparer comme de la brute, le Taïtien est ton frère. Vous êtes deux enfants de la nature ; quel droit as-tu sur lui qu’il n’ait pas sur toi ? Tu es venu ; nous sommes-nous jetés sur ta personne ? Avons-nous pillé ton vaisseau ? T’avons-nous saisi et exposé aux flèches de nos ennemis ? T’avons-nous associé dans nos champs au travail de nos animaux ? Nous avons respecté notre image en toi. Laisse-nous nos mœurs, elles sont plus sages et plus honnêtes que les tiennes. Nous ne voulons point troquer ce que tu appelles notre ignorance contre tes inutiles lumières. Tout ce qui nous est nécessaire et bon, nous le possédons. Sommes-nous dignes de mépris parce que nous n’avons pas su nous faire des besoins superflus ? Lorsque nous avons faim, nous avons de quoi manger ; lorsque nous avons froid, nous avons de quoi nous vêtir. Tu es entré dans nos cabanes, qu’y manque-t-il, à ton avis ? Poursuis jusqu’où tu voudras ce que tu appelles commodités de la vie ; mais permets à des êtres sensés de s’arrêter, lorsqu’ils n’auraient à obtenir, de la continuité de leurs pénibles efforts, que des biens imaginaires. Si tu nous persuades de franchir l’étroite limite du besoin, quand finirons-nous de travailler ? Quand jouirons-nous ? Nous avons rendu la somme de nos fatigues annuelles et journalières, la moindre qu’il était possible, parce que rien ne nous paraît préférable au repos. Va dans ta contrée t’agiter, te tourmenter tant que tu voudras ; laisse-nous reposer : ne nous entête ni de tes besoins factices, ni de tes vertus chimériques.
Extrait du Supplément au voyage de Bougainville , de Denis Diderot.
- Télécharger l'extrait
- Se procurer le livre
© 2024 Matthieu Binder. Réalisation Thomas Grimaud .
Mentions légales • Politique de confidentialité

Supplément au voyage de Bougainville - Résumé du livre
Denis diderot, résumé du livre "supplément au voyage de bougainville" ( denis diderot ).
Résumé du Supplément au voyage de Bougainville de Diderot. Notre fiche de résumé sur Le Supplément au voyage de Bougainville de Diderot a été rédigée par un professeur de français.
A propos du résumé
Rédacteur du résumé, titre du livre résumé, a propos du livre "supplément au voyage de bougainville".
Le Supplément au voyage de Bougainville est une oeuvre de Denis Diderot. Ecrivain talentueux, Denis Diderot écrit le conte philosophique 'Le Supplément au voyage de Bougainville' mais celui-ci ne sera publié qu'après sa mort, soit en 1796.
Le Supplément au Voyage de Bougainville est également intitulé \"Dialogue entre A et B sur l'inconvénient d'attacher des idées morales à certaines actions physiques qui n'en comportent pas\".
Ces analyses du livre "Supplément au voyage de Bougainville" pourraient également vous intéresser
- Supplément au voyage de Bougainville : Dialogue entre A et B
- Supplément au voyage de Bougainville : Pleurez malheureux tahitiens
- Supplément au voyage de Bougainville : Les adieux du vieillard
- Supplément au voyage de Bougainville : Fiche de lecture
- Supplément au voyage de Bougainville : Questionnaire
Ceux qui ont acheté ce résumé du livre "Supplément au voyage de Bougainville" ont également acheté
Tristan et Iseult
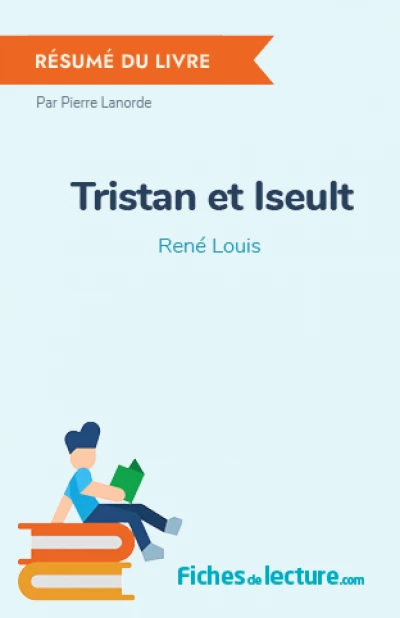
Mémoires d'Outre-Tombe
François-René de Chateaubriand
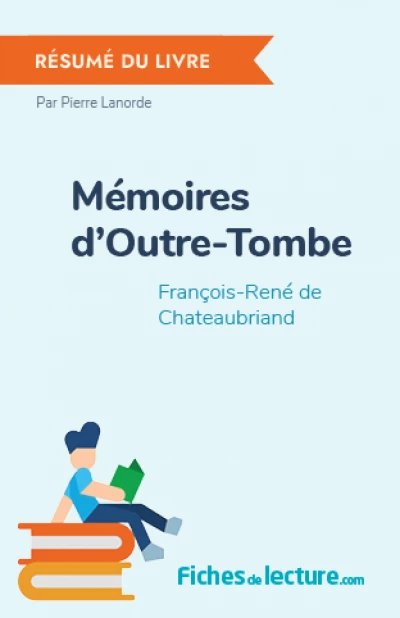
Le jeu de l'amour et du hasard
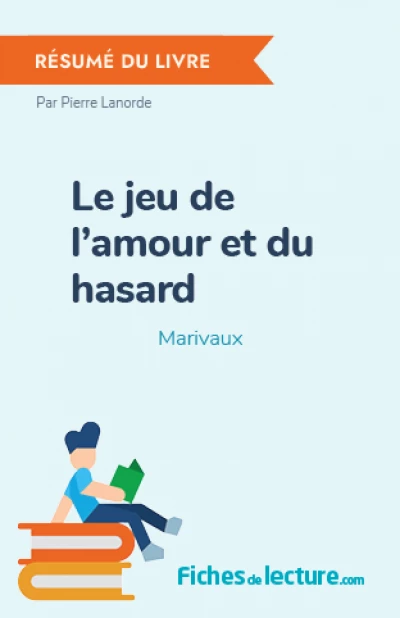
Hiroshima mon amour
Marguerite Duras
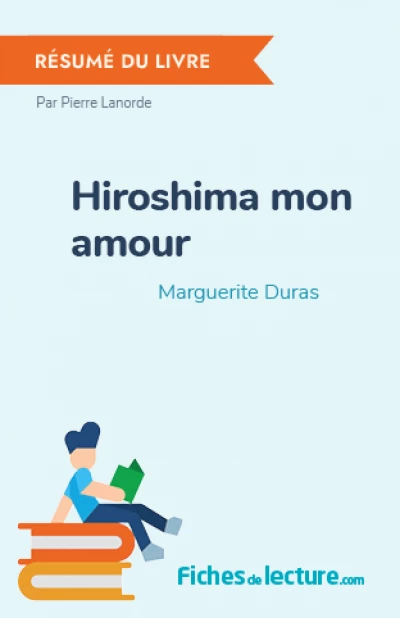

- Recherche par auteur ou oeuvre
- Recherche par idée ou thème
- Recherche par mot clé
- Détecteur de plagiat
- Commande & correction de doc
- Publier mes documents
- Nos astuces
- Vie étudiante
- Témoignages
Consultez tous nos documents en ligne !
à partir de 9.95 € sans engagement de durée
Supplément au voyage de Bougainville : résumé et analyse
Le Supplément au voyage de Bougainville est un dialogue (ou conte) philosophique écrit par Diderot et qui traite du voyage que le grand explorateur Bougainville avait fait en Océanie. Ici, Diderot aborde plusieurs sujets en rapport avec le colonialisme.

Credit Photo : Unsplash Joao Silas

En réalité, le vrai titre du texte est Supplément au voyage de Bougainville, ou Dialogue entre A et B sur l'inconvénient d'attacher des idées morales à certaines actions physiques qui n'en comportent pas . Il a été publié pour la première fois en 1796.
L'auteur et le contexte L'oeuvre
L'auteur et le contexte
Denis Diderot fait partie des écrivains des Lumières , il est né en 1713 et il est mort en 1784. Il est issu d'une famille bourgeoise aisée et même s'il était destiné à une vie de prêtre, il a finalement mené une vie de bohème.
Il se déclare athée, matérialiste et épicurien. Il est un des représentants majeurs de son époque et surtout, il est connu pour être le créateur de l' Encyclopédie .
Dans ce dialogue philosophique, l'écrivain donne la voix à tous ces Hommes qui avaient été victimes de la colonisation. C'est une dénonciation de l' injustice et une façon pour l'homme illustré de montrer du doigt les soi-disant « évolutions » des hommes habitant dans des sociétés modernes et occidentales.
L'ouvrage est composé de cinq chapitres :
1. Jugement du Voyage de Bougainville
Le livre commence par la conversation (le milieu d'une conversation) entre A et B. Ils parlent du ciel et du livre de Bougainville que l'un des deux est en train de lire. C'est de cette façon que sont introduites les questions du voyage de Bougainville et de la « vie sauvage ».
2. Les Adieux du vieillard
Alors que les Européens sont en voyage chez ces gens « à coloniser », un vieillard sort de chez lui quand ils s'apprêtent à rentrer chez eux pour leur dire que leur arrivée était déplorable. Il dit que Bougainville a apporté le vice et fait une large critique des moeurs de la civilisation européenne.
3. L'entretien de l'aumônier et d'Orou
L'auteur raconte ici la façon dont Orou (un Tahitien) aurait pu convaincre l'aumônier de passer la nuit avec sa fille ; en réalité, l'aumônier décline cette proposition en accord avec ses croyances religieuses. Le lendemain, le Tahitien lui pose des questions sur les interdictions sexuelles qui seraient contraires à la nature. Ensuite, ils discutent sur les moeurs des uns et des autres.
4. Suite de l'entretien de l'aumônier avec l'habitant de Tahiti
Dans ce chapitre, Orou et l'aumônier continuent à en apprendre plus sur les habitudes et la culture de l'autre. Ils passent en revue les grands thèmes sociétaux : l' inceste , l' adultère , le libertinage , etc.
5. Suite du dialogue entre A et B
Dans ce dernier chapitre, A et B établissent une comparaison des modes de vie otaïtien et européen. Ils se posent des questions sur la société , la fidélité , la constance, etc., ils se demandent s'il s'agit des principes de la nature. Ils s'interrogent aussi sur l'homme qui mène une « vie sauvage » et l'homme qui mène « une vie de ville », et ils les comparent. Enfin, ils terminent le chapitre en décidant de revenir aux lois de la Nature .
Source : Universalis
Les articles suivants peuvent t'intéresser : Comment analyser un schéma narratif ? Exemple avec Candide de Voltaire Le drame romantique Hernani de Victor Hugo : personnages, résumé et thèmes Fiche de lecture gratuite - La Peste de Camus Méthodologie de la lecture analytique
Besoin d'un tuteur ? Nous pouvons vous aider !
Documents conseillés, articles liés.

Mes forêts de Hélène Dorion - fiche de lecture d'une...

Sujet de bac 2023 philo : Vouloir la paix, est-ce vouloir...

Les droits de douane - thèmes de mémoire
Articles récents

Comment commencer un développement de dissertation ?

Discours du vieillard, Supplément au voyage de Bougainville, Diderot : analyse
Tu passes le bac de français ? CLIQUE ICI et deviens membre de commentairecompose.fr ! Tu accèderas gratuitement à tout le contenu du site et à mes meilleures astuces en vidéo.

L’extrait étudié va de « Pleurez malheureux tahitiens » jusqu’à « à vertus chimériques » .
« Le discours du vieillard », Supplément au Voyage de Bougainville, introduction :
Le Supplément au voyage de Bougainville s’inspire du voyage réel de l’explorateur Bougainville en Océanie et de son récit Voyage autour du monde, dans lequel est évoquée la colère du vieux tahitien.
Diderot, l’un des plus célèbres philosophes des lumières , choisit de mettre en avant le point de vue des tahitiens pour dénoncer les vices de la société européenne à travers le discours d’un vieux tahitien, qui parle au nom de la communauté.
Extrait étudié
Pleurez, malheureux Tahitiens ! pleurez ; mais que ce soit de l’arrivée, et non du départ de ces hommes ambitieux et méchants : un jour, vous les connaîtrez mieux. Un jour, ils reviendront, le morceau de bois que vous voyez attaché à la ceinture de celui-ci, dans une main, et le fer qui pend au côté de celui-là, dans l’autre, vous enchaîner, vous égorger, ou vous assujettir à leurs extravagances et à leurs vices ; un jour vous servirez sous eux, aussi corrompus, aussi vils, aussi malheureux qu’eux. Mais je me console ; je touche à la fin de ma carrière ; et la calamité que je vous annonce, je ne la verrai point. O Tahitiens ! mes amis ! vous auriez un moyen d’échapper à un funeste avenir ; mais j’aimerais mieux mourir que de vous en donner le conseil. Qu’ils s’éloignent, et qu’ils vivent. » Puis s’adressant à Bougainville, il ajouta : « Et toi, chef des brigands qui t’obéissent, écarte promptement ton vaisseau de notre rive : nous sommes innocents, nous sommes heureux ; et tu ne peux que nuire à notre bonheur. Nous suivons le pur instinct de la nature ; et tu as tenté d’effacer de nos âmes son caractère. Ici tout est à tous ; et tu nous as prêché je ne sais quelle distinction du tien et du mien. Nos filles et nos femmes nous sont communes ; tu as partagé ce privilège avec nous ; et tu es venu allumer en elles des fureurs inconnues. Elles sont devenues folles dans tes bras ; tu es devenu féroce entre les leurs. Elles ont commencé à se haïr; vous vous êtes égorgés pour elles ; et elles nous sont revenues teintes de votre sang. Nous sommes libres ; et voilà que tu as enfoui dans notre terre le titre de notre futur esclavage. Tu n’es ni un dieu, ni un démon : qui es-tu donc, pour faire des esclaves ? Orou ! toi qui entends la langue de ces hommes-là, dis-nous à tous, comme tu me l’as dit à moi, ce qu’ils ont écrit sur cette lame de métal : Ce pays est à nous. Ce pays est à toi ! et pourquoi ? parce que tu y as mis le pied ? Si un Tahitien débarquait un jour sur vos côtes, et qu’il gravât sur une de vos pierres ou sur l’écorce d’un de vos arbres : Ce pays appartient aux habitants de Tahiti, qu’en penserais-tu ?… Tu n’es pas esclave : tu souffrirais la mort plutôt que de l’être, et tu veux nous asservir ! Tu crois donc que le Tahitien ne sait pas défendre sa liberté et mourir ? Celui dont tu veux t’emparer comme de la brute, le Tahitien est ton frère. Vous êtes deux enfants de la nature ; quel droit as-tu sur lui qu’il n’ait pas sur toi ? Tu es venu ; nous sommes-nous jetés sur ta personne ? avons-nous pillé ton vaisseau ? t’avons-nous saisi et exposé aux flèches de nos ennemis ? t’avons-nous associé dans nos champs au travail de nos animaux ? Nous avons respecté notre image en toi. « Laisse nous nos moeurs ; elles sont plus sages et honnêtes que les tiennes ; nous ne voulons plus troquer ce que tu appelles notre ignorance contre tes inutiles lumières. Tout ce qui nous est nécessaire et bon, nous le possédons. Sommes-nous dignes de mépris, parce que nous n’avons pas su nous faire des besoins superflus ? Lorsque nous avons faim, nous avons de quoi manger ; lorsque nous avons froid, nous avons de quoi nous vêtir. Tu es entré dans nos cabanes, qu’y manque-t-il, à ton avis ? Poursuis jusqu’où tu voudras ce que tu appelles les commodités de la vie ; mais permets à des êtres sensés de s’arrêter, lorsqu’ils n’auraient à obtenir, de la continuité de leurs pénibles efforts, que des biens imaginaires. Si tu nous persuades de franchir l’étroite limite du besoin, quand finirons-nous de travailler ? Quand jouirons-nous ? Nous avons rendu la somme de nos fatigues annuelles et journalières la moindre qu’il était possible, parce que rien ne nous paraît préférable au repos. Va dans ta contrée t’agiter, te tourmenter tant que tu voudras ; laisse-nous reposer : ne nous entête ni de tes besoins factices, ni de tes vertus chimériques.
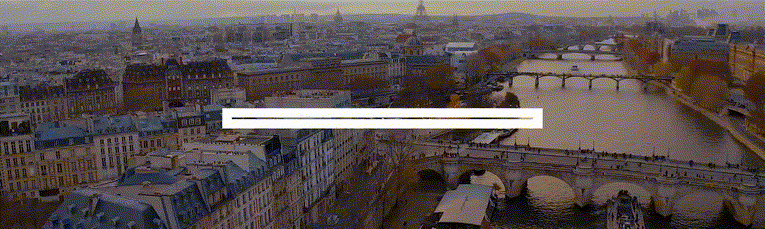
Questions possibles à l’oral de français sur « les adieux du vieillard » dans Supplément au voyage de Bougainville :
♦ Quels sont les enjeux du discours du vieux tahitien ? ♦ Quelle vision ce discours donne-t-il de la société européenne ? Par quels moyens ? ♦ En quoi ce texte reflète-t-il la pensée des philosophes des Lumières ? ♦ En quoi ce texte est-il une utopie ? ♦ Comment est représentée la société tahitienne dans le discours du vieillard ? ♦ Dans quelle mesure ce texte illustre-t-il le mythe du bon sauvage ?
Annonce du plan
Nous verrons comment la critique violente de la civilisation européenne (I) donne par contraste une vision utopique de la vie sauvage (II) grâce à la stratégie argumentative mise en place par Diderot (III).
I – Une critique de la civilisation européenne
A – la critique de la colonisation.
Le vieux tahitien critique vivement la colonisation de Tahiti.
Il dénonce tout d’abord ce qu’est réellement la colonisation : un vol régi par un rapport de force. On observe ainsi le champ lexical du pillage : « égorger » , « corrompus » , « vils » , « chef des brigands » , « le vol de toute une contrée » .
L’omniprésence de déterminants et de pronoms possessifs souligne le désir de possession des colonisateurs : « Ce pays est à nous » , « du tien et du mien », « Nos filles et no s femmes », « votre sang », « dans notre terre le titre de notre futur esclavage »
Ce rapport de force s’accompagne de violence et de cruauté : « fureurs », « féroce », « égorgés », « teintes de votre sang », « vengé », « vol », « t’emparer comme de la brute », « jetés », « pillé », « saisi et exposé aux flèches ».
Les colonisateurs ne cherchent qu’à réduire les tahitiens en esclavage , comme le souligne le polyptote « esclavage » et « esclaves » ainsi que le champ lexical de l’ esclavage : « enchaîner », « assujettir », « servirez sous eux », « t’obéissent », « nous asservir ».
L’ antithèse entre liberté et esclavage est mise en évidence tout au long des adieux du vieillard à travers les parallélismes : ♦ « Nous sommes libres ; // et voilà que tu as enfoui dans notre terre le titre de notre futur esclavage »; ♦ « Ce pays est à nous . // Ce pays est à toi ! »; ♦ « Tu n’es pas esclave : tu souffrirais la mort plutôt que de l’être, // et tu veux nous asservir ! ».
Au delà de la colonisation, c’est la civilisation européenne elle-même qui est visée par le vieux tahitien.
B – La critique des valeurs de la société européenne
En dénonçant le comportement des colonisateurs, le vieillard dénonce en réalité les valeurs de la civilisation européenne : la propriété , la violence et le matérialisme .
L’idée de propriété est au cœur de la civilisation européenne : « Tu nous a prêché je ne sais quelle distinction du tien et du mien » .
Cette idée s’applique non seulement aux bien matériels et aux terres (« Ce pays est à nous » ), mais également aux êtres humains puisque les colonisateurs s’approprient les femmes tahitiennes et réduisent les tahitiens en esclavage.
Or ce rapport de possession engendre violence et jalousie : « tu es venu allumer en elles des fureurs inconnues » , « elles sont devenues folles dans tes bras » . Elle crée également une compétition violente entre les hommes : « vous vous êtes égorgées pour elles » .
Le vieillard dénonce également une société matérialiste mue par des « besoins superflus » (il s’agit là d’un oxymore puisqu’un besoin est forcément nécessaire).
Cette quête insensée de « besoins factices » ne crée qu’ épuisement et agitation : « pénibles efforts » , « fatigues annuelles et journalières » , « t’agiter, te tourmenter » .
Transition : Cette vision négative de la civilisation européenne contraste avec la représentation utopique de la vie sauvage.
II – Une vision utopique de la vie sauvage
A – eloge de la simplicité des tahitiens.
Derrière la critique de la civilisation européenne transparaît l’ éloge de la vie sauvage.
Les tahitiens sont en symbiose avec la nature , ce qui est marqué par la présence d’un champ lexical de la nature : « morceau de bois », « rive », « la nature », « terre », « côtes », « pierres », « l’écorce d’un de vos arbres », « champs », « animaux », « cabanes ».
Tout ce dont ils ont besoin, les tahitiens le trouvent dans la nature.
Ainsi, ils ne manquent de rien, ce qui est renforcé par l’ hyperbole « Tout » (« Tout ce qui nous est nécessaire et bon, nous le possédons» ) et la structure binaire des phrases qui suggère la facilité avec laquelle ils subviennent à leurs besoins : « Lorsque nous avons faim, nous avons de quoi manger ; lorsque nous avons froid, nous avons de quoi nous vêtir ».
Les tahitiens vivent selon une morale épicurienne qui consiste à borner ses ambitions ou ses désirs pour atteindre le bonheur dans une vie simple .
Dénués de « besoins superflus » , ils consacrent du temps à jouir de la vie et à se reposer (« Quand jouirons-nous ? « , « rien ne nous paraît préférable au repos » ).
On assiste à un renversement de valeur puisque c’est l’ oisiveté – et non le travail – qui est présentée comme souhaitable par le vieux tahitien.
B – Tolérance et ouverture d’esprit
La société tahitienne est basée sur des valeurs fondamentales : ♦ La liberté : « Nous sommes libres » ; ♦ L’égalité et la fraternité :« le Tahitien est ton frère. Vous êtes deux enfants de la nature; quel droit as-tu sur lui qu’il n’ait pas sur toi ? » ; ♦ Le partage : « Ici tout est à tous », « Nos filles et nos femmes nous sont communes ; tu as partagé ce privilège avec nous » ; ♦ La tolérance : « Nous avons respecté notre image en toi » .
La notion de partage irrigue la société tahitienne : « Ici tout est à tous » , « Nos filles et nos femmes nous sont communes » .
Leur altruisme n’est pas uniquement tourné vers les individus de leur communauté, mais étendu à tous les êtres humains . La fraternité est mise en valeur dans le discours du vieillard : « Vous êtes deux enfants de la nature » , « le Tahitien est ton frère » , « Nous avons respecté notre image en toi » .
Les tahitiens sont même si respectueux de la vie humaine qu’ils préfèrent laisser partir les européens plutôt que de les tuer pour mettre fin à la colonisation : « Tahitiens ! Vous auriez un moyen d’échapper à un funeste avenir; mais j’aimerais mieux mourir que de vous en donner le conseil. Qu’ils s’éloignent et qu’ils vivent. »
Ainsi, on retrouve dans Supplément au voyage de Bougainville la représentation du mythe du bon sauvage , avec une vision proche de celle de Rousseau : l’homme est bon à l’état de nature , alors que la civilisation le corrompt.
Transition : En donnant la parole au vieux tahitien, Diderot met en place une stratégie argumentative solide pour convaincre et persuader ses lecteurs.
III – La stratégie argumentative mise en place par Diderot
A – un discours à forte tonalité polémique.
Les adieux du vieux tahitien apparaissent comme un véritable réquisitoire à l’encontre des européens, réquisitoire dominé par une tonalité polémique .
Cette tonalité polémique transparaît tout d’abord dans la ponctuation forte .
Les nombreuses phrases exclamatives et interrogatives associées à des apostrophes traduisent l’indignation du vieillard : « Pleurez, malheureux Tahitiens ! » , « O Tahitiens ! mes amis ! » , « qui es-tu donc, pour faire des esclaves ? Orou ! » , « Ce pays est à toi ! et pourquoi ? parce que tu y as mis le pied ? ».
L’accumulation des questions rhétoriques renforce l’incompréhension du tahitien face au comportement des européens.
Cette colère est renforcée par l’emploi de l’ impératif et les interjections et apostrophes injurieuses : « Pleurez , malheu r eux T ahitiens ! pleurez ; mais que ce soit d e l’a rr ivée, et non d u d é p a r t d e ces hommes ambitieux et méchants », « Et toi, chef des brigands qui t ’obéissent, écarte pr om pt ement t on vaisseau d e no tr e r ive », « Laisse-nous nos mœu r s », « Va d ans t a con tr ée t ’agi t er, t e t ou r men t er t ant que t u vou dr as ; laisse-nous r e p oser : ne nous entête ni d e t es besoins fac t ices, ni d e t es ve rt us chimé r iques ».
La colère du vieux tahitien est amplifiée par les sonorités agressives et virulentes , comme les allitérations en « r », « p », « d » et « t » qui martèlent le discours.
Enfin, la brièveté des phrases , majoritairement séparées par des points-virgules , créée un rythme saccadé qui traduit la virulence du vieux tahitien.
B – Un discours raisonné
Mais derrière ce violent réquisitoire se cache un discours construit et raisonné .
Le vieux tahitien fait des constats basés sur des observations , ce qui est marqué par l’emploi du passé composé : « tu as tenté », « tu nous as prêché », « tu es venu », « Elles sont devenues », « Elles ont commencé », « Tu es venu ; nous sommes-nous jetés sur ta personne ?[…]Nous avons respecté notre image en toi ».
Il invite les européens à se mettre à la place de l’autre : « Nous sommes-nous jetés sur ta personne ? » , « T’avons-nous saisi et exposé aux flèches ? » et leur oppose une philosophie de vie réfléchie : « Tout ce qui nous est nécessaire et bon, nous le possédons. »
Le vieillard n’est pas aveuglé par la haine. Il refuse d’utiliser la violence contre les colonisateurs (« Vous auriez un moyen d’échapper à un funeste avenir; mais j’aimerais mieux mourir que de vous eu donner le conseil . » ) et met sans cesse en relief la fraternité qui unit tous les hommes : « le Tahitien est ton frère « , « Nous avons respecté notre image en toi « .
Alors que les européens se persuadent de leur supériorité et pensent apporter leurs « lumières » aux tahitiens (« Nous ne voulons point troquer ce que tu appelles notre ignorance contre tes inutiles lumières. » ), le discours structuré du vieillard , sa tolérance , son analyse et son ouverture d’esprit contredisent la prétendue ignorance des tahitiens.
Les Tahitiens sont finalement les modèles d’une humanité ouverte et généreuse. Diderot opère une inversion ironique : les prétendus civilisés sont barbares et les sauvages sont civilisés .
Les adieux du vieillard, Supplément au voyage de Bougainville, conclusion :
A travers le discours à la fois spontané et construit du vieux tahitien, Diderot critique la colonisation et la civilisation européenne.
Par contraste, il fait l’ éloge du mode de vie et des mœurs des Tahitiens .
A l’instar d’autres philosophes comme Montaigne au 16ème siècle et Rousseau au 18ème siècle, Diderot reprend ici le mythe du bon sauvage pour dénoncer les vices de la civilisation européenne .
Tu étudies Supplément au voyage de Bougainville ? Regarde aussi :
♦ Supplément au voyage de Bougainville, Diderot, histoire de Polly Baker ♦ Supplément au voyage de Bougainville, Diderot, l’aumônier ♦ Lettres persanes, Montesquieu [fiche de lecture] ♦ Voltaire [fiche auteur] ♦ « De l’esclavage des nègres », Montesquieu : analyse ♦ L’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert ♦ Jacques le fataliste, incipit : analyse ♦ Jean-Jacques Rousseau [Fiche auteur]

Les 3 vidéos préférées des élèves :
- La technique INCONTOURNABLE pour faire décoller tes notes en commentaire [vidéo]
- Quel sujet choisir au bac de français ? [vidéo]
- Comment trouver un plan de dissertation ? [vidéo]
Tu entres en Première ?
Commande ton livre 2024 en cliquant ici ⇓.
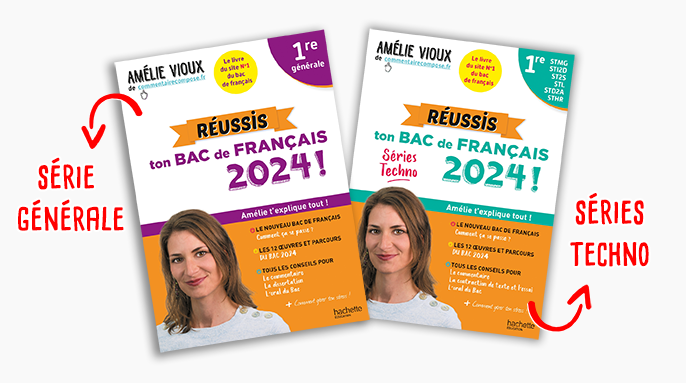
Qui suis-je ?
Amélie Vioux
Je suis professeur particulier spécialisée dans la préparation du bac de français (2nde et 1re).
Sur mon site, tu trouveras des analyses, cours et conseils simples, directs, et facilement applicables pour augmenter tes notes en 2-3 semaines.
Je crée des formations en ligne sur commentairecompose.fr depuis 12 ans.
Tu peux également retrouver mes conseils dans mon livre Réussis ton bac de français 2024 aux éditions Hachette.
J'ai également publié une version de ce livre pour les séries technologiques ici.
29 commentaires
Merci pour votre site qui m’aide beaucoup pour les commentaires. Je dois faire un plan détaillé mais j’ai beaucoup de mal à comprendre la consigne pouvez vous m’aider ?
Bonjour, merci pour ce commentaire, j’aurai une question car je ne comprend pas qui/quoi représente « le morceau de bois » et « le fer », au début du discours? Merci
Le morceau de bois est la croix qui fait écho à une colonisation pour motif religieux (convertir le nouveau peuple aux religions européennes) et le morceau de fer symbolise l’épée et donc la conquête armée.
Merci pour le travail Amélie vous êtes géniale, pour l’année prochaine essayez de nous présenter quelques auteurs Africains
Désolé de vous derranger, mais ca serait possible que vous me donniez un exemple en relation avec: • La rigueur et la volonté d’objectivité de l’argumentation directe n’excluent pas pour autant l’implication de l’auteur, qui a le loisir d’ajouter une dimension personnelle à son argumentation, ce qui peut renforcer l’intérêt du lecteur et provoquer ses réactions (hostiles ou favorables) Vous me serez de grande aide, Merci d’avance 🙂
Vos commentaires sont très intéressants et construits. Je m’en sers souvent pour compléter mes propres commentaires. Je vous remercie et vous félicite pour votre travail!
Je passe le bac cette année et je peux vous dire que vous avez été d’une très grande aide pour toute ma classe y compris mon prof de français ! (oui elle nous imprime tout vos commentaires) en tout cas votre site est génial merci
Merci Melissa 🙂
elle se foule pas trop votre prof dis-donc…
Bonjour, j’aimerais savoir les Taitiens sont maudits depuis le jour où Bougainville a abordé leurs terres
Amélie t’es grave la meilleure <3
Le site est parfait et je m’en sert pour compléter le cours de ma prof cependant quelques uns ne sont pas sur le site. Est ce que vous connaissez un autre site aussi bien que le votre?
Je n’en connais pas d’autres… J’ai d’ailleurs créé mon site car je trouvais qu’il n’y avait pas grand chose de qualitatif et fiable sur internet.
Quels vices de la civilisation européenne sont dénoncés par le vieillard tahitien
Quel stratégie pour perduader le viellard utilise t-il ?
Tout est expliqué dans mon commentaire : relis le texte puis relis mon commentaire pour t’aider à élaborer une réponse personnelle.
j’aime
Bonjour , votre travail est très bien mais le souci est que mon texte commence : » Puis s’adressant a Bougainville , il ajouta:… ».si je travaille votre commentaire avec le paragraphe en plus c’est bon ou non ? Je n’ai pas eu de français car prof absents , remplacé récemment je n’ai pas travaillé dessus , je veux savoir comment procédé pour réviser l’oral par exemple avec vos commentaire ou autres ?je n’ai aucune méthode merci de m’eclairer..!
Bonjour je dois rédiger en français en sujet d’invention la réponse de bougainvillée au vieux thaicidn auriez vous des idées pour m’aider merci
bonjour Amelie Je passe mon oral de francais demain et j’ai vraiment un probleme mon professeur de francais de cette année ne nous donne pas d’explication des textes à l’ecrit, elle ne fait qu’expliquer à l’oral les textes, sans dicter. je me suis donc beaucoup aidé de ton site afin de faire mes propores explications de textes. J’ai donc pu retrouver l’explication de 18 textes grace a votre site, mais il m’en reste que je n’ai pas pu trouver ici: l’ingénu de Voltaire, chapitre 14 et Emile de Rousseau, livre 5 (allant de « il est utile à l’homme…à ainsi voyagera mon Emile) J’ai pu trouvé une explication assez vaste de l’ingenu sur un autre site mais pas aussi bien détaillé que le votre. Et mon vrai problème c’est surtout Emile: son explication est introuvable. j’angoisse beaucoup à l’idee de tomber sur ce texte C’est pour cela que je me demandais si c’est possible que vous publiez l’analyse d’Emile, afin que je connaisse tout mes textes pour mon oral. J’espère que vous lirez mon message. Dans tout les cas je tenais à vous dire que vos explications et vos conseils m’ont ete tres benefiques autant pour mes textes à l’oral que pour l’ecrit, bien plus qu’en cours. Merci d’avance et bonne journée.
Bonjour, Il m’est impossible de publier des lectures analytiques sur commande. C’est un travail très long que je réalise au fur et à mesure de l’année. Je choisis en outre des textes souvent donnés au bac de français afin qu’ils intéressent le plus grand nombre.
Bonjour, Est ce qu’il est possible de faire une ouverture sur un film? (ici l’enfant sauvage de Francois truffaut en rapport avec le mythe du bon sauvage et de la perversion de l’homme en société?)
Oui bien sûr, c’est possible.
Sur quel autre texte pourrait-on ouvrir ?
On pourrait ouvrir sur le chapitre 17 de Candide où tout est agréable à l’Eldorado , monde de plaisir , de savoir-vivre ect
Ou sinon on pourrait ouvrir sur le discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes de Rousseau : Il fait le blâme de l’homme civilisé et l’éloge de l’homme sauvage à travers un essai construit à visée polémique!!
Bonjour Amélie, Ma lecture analytique n’a pas la même découpe que la votre, je m’explique, le texte commence à « Et toi, chef des brigands » et elle s’arrête plus moins, c’est à dire à « nous commettrons pour en arrêter le poison ». Pensez-vous que je peux quand même utiliser votre plan? Au plaisir de votre réponse.
Bonjour Amélie,
Je ne suis pas sûr mais je pense que le « Supplément au voyage de Bougainville » date de 1772 et non 1796, car Diderot l’a publié une année après la publication de celui de Bougainville (celui-ci publié en 1771).
De plus, tu as fait une faute de frappe : tu as mis III) A) deux fois dans le commentaire
Par ailleurs, je pense personnellement que ça serait une bonne idée de faire une ouverture en conclusion sur l’oeuvre du Baron de Lahontan « Dialogue entre le baron de lahontan et un sauvage d’Amérique » dans la mesure où le huron met en accusation les Européens, ayant une mauvaise influence sur les sauvages canadiens à travers un discours tout aussi raisonné et construit que celui du vieux Tahitien.
Bonjour, Tu confonds date d’écriture et de publication : Supplément au voyage de Bougainville a probablement été écrit en 1772 et remanié plusieurs fois jusque vers 1780, mais a été publié seulement en 1796 (après la mort de Diderot). Pour la conclusion, il est en effet pertinent de faire un lien avec un autre texte qui reprend le mythe du bon sauvage.
Laisse un commentaire ! X
Merci de laisser un commentaire ! Pour des raisons pédagogiques et pour m'aider à mieux comprendre ton message, il est important de soigner la rédaction de ton commentaire. Vérifie notamment l'orthographe, la syntaxe, les accents, la ponctuation, les majuscules ! Les commentaires qui ne sont pas soignés ne sont pas publiés.
Site internet
Découvrir, comprendre, créer, partager
- Supplément au voyage de Bougainville

Bibliothèque nationale de France
Vue de la Nouvelle-Cythère, découverte par M. de Bougainville en 1768
Au début du 18 e siècle, l’océan Pacifique où les Européens n’ont qu’un seul comptoir, aux Philippines, reste en partie méconnu. Les débats sur l’existence d’un continent austral sont relancés, de nouvelles explorations engagées. En 1766, Bougainville embarque avec un cartographe, un astronome et le naturaliste Commerson pour le premier voyage scientifique français autour du monde. Terminé en 1769 après une abominable traversée du Pacifique, le voyage de Bougainville laisse entier le mystère des terres australes. Mais grâce à lui, la France a connu Tahiti.
Bougainville aborde à Tahiti le 6 avril 1768. Le lendemain, dans son journal de navigation, il s’extasie devant « la douceur du climat, la beauté du paysage, la fertilité du sol partout arrosé de rivières et de cascades, la pureté de l’air ». Tout, selon lui, « inspire la volupté ». Et de baptiser cette terre paradisiaque « Nouvelle Cythère », du nom de l’île grecque consacrée à Aphrodite qui passait pour le pays idyllique de l’amour et du plaisir.
Supplément au voyage de Bougainville dans le texte
Cet article provient du site Les Essentiels de la littérature (2015).
Lien permanent
ark:/12148/mmn0qrv0vc82f
- 18 e siècle
- Philosophie
- Littérature
- Conte philosophique
- Denis Diderot
- Colonisation
- Analyses de livres
- Questionnaires
- Commentaires de texte
- Bac Français 2024
- LePetitLittéraire.fr
Supplément au Voyage de Bougainville - Résumé du livre

de Denis Diderot
- Description de ce résumé
- Infos techniques
À propos de ce résumé de Supplément au Voyage de Bougainville
Ce document propose un résumé clair et détaillé de Supplément au Voyage de Bougainville de Denis Diderot, dont voici un extrait :« Partie I : Jugement du voyage de BougainvilleEn attendant que le brouillard se lève pour pouvoir sortir, B lit le Voyage autour du monde de Bougainville, un récit que ce dernier a écrit après une grande expédition maritime qui l’a mené dans des contrées lointaines. B fait part de son enthousiasme à A.Il évoque plusieurs « choses singulières » que l’explorateur décrit de ses voyages, comme les Patagons, un peuple d’Amérique du sud qui, affirme-t-il, sont de toute petite taille mais ont les membres et la tête d’une grosseur surnaturelle. Pourtant, A se doute bien qu’il s’agit là d’inventions : « Né avec le goût du merveilleux qui exagère tout autour de lui, comment l'homme laisserait-il une juste proportion aux objets, lorsqu'il a pour ainsi dire à justifier le chemin qu'il a fait et la peine qu'il s'est donnée pour les aller voir au loin ? » (p. 288) »Découvrez la suite dans le document.
Également recommandé pour Supplément au Voyage de Bougainville
Pour aller plus loin dans votre compréhension de l'oeuvre de Denis Diderot , nous vous conseillons aussi de consulter notre Analyse de Supplément au Voyage de Bougainville qui propose une présentation de l'auteur et du livre, suivie d'un résumé, d'une analyse des personnages et des clés de lecture.
Informations techniques
ISBN numérique : 9782806220653-RES
Analyse de : Fanny Normand
Partager ce résumé
Ces analyses du livre "Supplément au Voyage de Bougainville" pourraient également vous intéresser
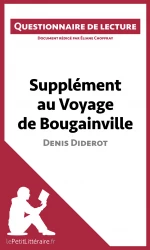
Pourquoi s'abonner ?
Avec l'abonnement lePetitLitteraire.fr, vous accédez à une offre inégalée d’analyses de livres :
Ceux qui ont téléchargé ce résumé du livre "Supplément au Voyage de Bougainville" ont également téléchargé
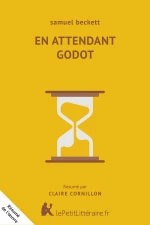
Réussis tes études avec des analyses faites par des professeurs !
Dès 0,99 € par fiche de lecture
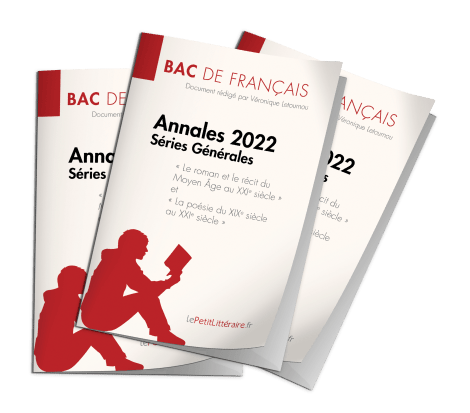
Extrait du résumé du livre Supplément au Voyage de Bougainville
Structure de ce résumé de livre.
Ce document a été rédigé par Fanny Normand
Fanny Normand est titulaire d'un master 2 en littératures comparées (Université Paris-Sorbonne)
Validé par des experts en littérature
En savoir plus
Fanny Normand
Analyses rédigées par ce rédacteur.
- Supplément au Voyage de Bougainville (Résumé du livre)
- Nadja (Résumé du livre)
- Les Femmes savantes (Résumé du livre)
- Supplément au Voyage de Bougainville (Analyse du livre)
- Les Femmes savantes (Analyse du livre)
- Nadja (Analyse du livre)
Analyses littéraires
Les Fleurs du mal
La Femme de trente ans
Suite française
La Servante écarlate
Contes de la Bécasse
Toutes les analyses
Simone Veil
Herman Melville
Guillaume Apollinaire
Tonino Benacquista
Tous les auteurs
Aide et support
Sécurité des paiements
Conditions générales
Règles de confidentialité
Contacter le support
Toutes les FAQs
Exemples de résumés gratuits
Copyright © LEMAITRE Éditions, 2024
- 50minutes.fr
- 50minutes.com
Supplément au voyage de Bougainville: résumé et analyse
SUPPLÉMENT AU VOYAGE DE BOUGAINVILLE. Dialogue philosophique de Denis Diderot (1713-1784), dont le titre complet est: Supplément au Voyage de Bougainville, ou Dialogue entre A et B sur l’inconvénient d’attacher des idées morales à certaines actions physiques qui n’en comportent pas, publié par l’abbé Bourlet de Vauxcelles dans Opuscules philosophiques et littéraires à Paris chez Chevet en 1796. Le «discours de Polly Baker» (III) apparaît pour la première fois dans l’édition de Gilbert Chinard, donnée à Genève chez Droz en 1935 d’après le manuscrit de Leningrad.
Résumé du S upplément au voyage de Bougainville :
- «Jugement du Voyage de Bougainville». Par un temps de brouillard, B rapporte avec enthousiasme à A les singularités du récit du navigateur et vante la vie naturelle des sauvages, qu’illustre Aotourou, Tahitien amené en France. Un prétendu Supplément au Voyage sera le garant de ses dires.
- «Les Adieux du vieillard». Le Supplément s’ouvre sur le discours adressé à Bougainville avant son départ par un vieux Tahitien, qui dénonce violemment les maux apportés dans l’île par les Européens.
- «L’Entretien de l’aumônier et d’Orou». Le Supplément dit ensuite comment le Tahitien Orou réussit à convaincre l’aumônier de l’équipage de passer la nuit avec sa fille et le questionna, le lendemain, sur ce Dieu dont les interdictions sexuelles sont contraires à la nature. Suit un discours, rapporté par B, de Polly Baker, mère célibataire condamnée pour libertinage.
- «Suite de l’entretien de l’aumônier avec l’habitant de Tahiti». À Tahiti où la maternité est reine, poursuit Orou, seules sont jugées libertines les femmes stériles qui ont commerce avec des hommes. C’est l’intérêt et non le devoir qui garantit l’ordre public. Convaincu ou poli, l’aumônier honore successivement les autres filles et la femme de son hôte.
- «Suite du dialogue entre A et B». Face à A sceptique, B conclut que la loi de nature supplée aisément aux codes religieux et civils, qui ont dénaturé l’union des sexes. Mais il vaut mieux se conformer aux lois de son pays plutôt que d’être sage parmi les fous. Retour symbolique du beau temps.
Analyse du Supplément :
Une utopie critique :.
Inspirée par le Voyage autour du monde (1771) de Louis Antoine de Bougainville, l’œuvre de Diderot participe du «mirage océanien» qui fit voir en Tahiti la nouvelle Cythère. Mais elle n’a rien d’un divertissement exotique ou grivois ; l’utopie tahitienne permet à l’auteur, comme l’indique le sous-titre, de mettre en cause le lien qu’établissent nos sociétés chrétiennes entre relations sexuelles et moralité. À ce titre, le Supplément ne se conçoit pas sans Ceci n’est pas un conte et Madame de La Carlière qui, portant sur la morale sexuelle, forment avec lui un triptyque. Les amours désastreuses autant que policées des personnages de ces contes, cités à la fin du Supplément , servent de prélude à l’évocation de la sexualité libre et heureuse des sauvages tahitiens, qui illustre la conciliation possible entre l’amour et les mœurs. La réflexion morale débouche ainsi, dans cette œuvre que l’on a parfois considérée comme l’expression de la pensée ultime de Diderot, sur une théorie politique, fondée sur l’accord entre les lois et la nature. Les mauvaises mœurs ne sont pour Diderot que l’effet d’une mauvaise législation : en bridant les appétits naturels, les codes religieux et civil ont, dans l’Europe vieillissante, corrompu les mœurs. La jeune société tahitienne, elle, a atteint ce point d’équilibre qui la situe à mi-chemin entre les rigueurs du primitivisme et la dégénérescence qui guette toute civilisation. On aurait tort, pourtant, de voir avec Vauxcelles dans le Supplément une «sans-culotterie» ; la «conclusion» du texte n’a rien de révolutionnaire, qui édicte : «Nous parlerons contre les lois insensées jusqu’à ce qu’on les réforme, et en attendant nous nous y soumettrons.»
Il paraît difficile, en effet, au nom d’une illusoire cohérence de la pensée diderotienne, d’interpréter l’œuvre polyphonique qu’est le Supplément à la lumière de la seule diatribe anticolonialiste du vieillard ou même de la sévère critique faite par Orou de la morale chrétienne. Il ne faut pas oublier qu’en 1772, au moment de la rédaction du Supplément , le philosophe mariait sa fille le plus bourgeoisement du monde. Rêverie à la manière de Diderot (nous savons combien était codifiée et hiérarchisée cette société tahitienne), le Supplément énonce seulement l’hypothèse d’une autre organisation sociale, dont le philosophe tire ailleurs, dans l’Histoire des deux Indes , des conséquences plus radicales. Ce que Diderot a en tête ici, à la veille de son départ pour Saint-Pétersbourg, c’est un projet de réforme applicable dans la toute jeune Russie, dont il fera état dans ses Mémoires pour Catherine II .
Une pensée en mouvement :
On a pu qualifier de «baroque» l’art de Diderot et déceler dans l’arrangement, voire le contenu du Supplément , des contradictions. L’auteur semble, il est vrai, défier toute logique en plaçant le discours d’adieu avant l’arrivée de l’équipage, en confondant dans le titre «supplément» et «dialogue» qui alternent dans l’œuvre, en prêtant tour à tour à ses apparents porte-parole (B? le vieillard? Orou?) des discours divergents. Mais ne faut-il pas plutôt voir dans cette structure éclatée le signe d’une pensée en mouvement, favorisée par les vertus du dialogue et de la supplémentarité ? Les cinq sections du Supplément, qui s’articulent fermement autour d’une lecture de Bougainville, abordent les mêmes thèmes (liberté, propriété, comportement matrimonial...), mais les orchestrent différemment. Si la conversation initiale exalte à travers Bougainville les Lumières, le discours du vieillard lui oppose la corruption européenne, qui appelle un remède, proposé par Orou dans l’entretien avec l’aumônier : la conversion aux lois de la nature. À la fin du dialogue entre A et B, le directeur de l’Encyclopédie, disant son dernier mot, réaffirme sa foi dans le progrès, qu’il avait mise entre parenthèses pour «abandonne[r] [son] esprit à tout son libertinage» (début du Neveu de Rameau ). En cela il se distingue du Rousseau des Discours, dont la critique morale est sous-tendue par une volonté de réforme politique.
Le thème central du Supplément n’est pas neuf. Depuis Montaigne, les «philosophes nuds» avaient fait florès dans la littérature française et le Supplément véhicule bien des idées répandues chez les contemporains de Diderot (le populationnisme, par exemple). L’originalité de Diderot réside dans l’accent qu’il met sur le caractère physiologique de l’amour. C’est sans doute ce qui explique le retentissement de l’œuvre, qui inspira à Musset quelques strophes du poème “Souvenir”, ne fut pas étrangère aux thèses du socialiste Paul Lafargue sur «le droit à la paresse» et fut l’objet d’un pastiche de Giraudoux, le Supplément au Voyage de Cook (1935).
ALBERTAN-COPPOLA, in Dictionnaire des oeuvres littéraires de langue française. © Bordas, Paris 1994
Plus d'articles:
Fiche : Les lumières (XVIIIe siècle)
Bac de français
Pour aller plus loin:
La petite vadrouille, un film de Bruno Podalydès, sortie en salles le 5 juin 2024
Publié le mercredi 15 mai 2024 à 15h29
Une croisière fluviale en famille, une arnaque collective… « Les personnages sont loin d’être parfaits. Ils sont sympathiquement imparfaits, sans trop de souci moral ». Un partenariat France Inter.
Un patron ( Daniel Auteuil ) prêt à dépenser quatorze mille euros pour que sa collaboratrice lui organise un week-end insolite en amoureux. Une collaboratrice ( Sandrine Kiberlain ) et son mari ( Denis Podalydès ) qui voient là l’occasion de remettre leurs finances et celles de leurs copains à flot… tout en escroquant gentiment ces derniers. Dans le film, Tout le monde manipule tout le monde.
Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité . Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt.
Résumé : Justine, son mari et toute leur bande d’amis trouvent une solution pour résoudre leurs problèmes d’argent : organiser une fausse croisière romantique pour Franck, un gros investisseur, qui cherche à séduire une femme .
Alors que l’ère du temps nous pousse à aller toujours plus vite, Bruno Podalydès prend le contre temps de cette injonction :
« C’est un projet que j’ai en tête depuis 2003, du moment où j’ai commencé à faire de petites croisières fluviales en famille. J’ai adoré ce mode de vacances. Petit à petit, j’ai découvert une multitude de canaux - il est extrêmement facile de circuler en bateau du sud de la France jusqu’en Allemagne, et même au-delà, tant le réseau de ces canaux est riche. Mais il faut un rapport au temps apaisé pour ce genre de voyage. Je rêvais d’une histoire qui puisse se dérouler dans ce rythme et ce cadre. Est venu se greffer le récit de cette croisière bidonnée, dont l’effet troupe me séduisait. Mon amour sans doute pour « To Be or Not To Be », d’ Ernst Lubitsch , que j’ai vu et revu et qui m’a tant marqué… »
Bruno Podalydès , met en scène ses complices de toujours ainsi que des petits nouveaux, venus compléter la distribution, donnant à l’ensemble un irrésistible effet de troupe.
Il précise cependant :
« Je n’ai pas toujours un rôle pour chacun ! Ce qui est bien, c’est que je peux compter sur eux à chaque fois. Aucun ne s’arrête à l’épaisseur du rôle – je pense à Patrick Ligardes qui, au début du film, joue le type qui attrape mon personnage en train de voler un pédalo et qui lui confie la pénichette. Une simple scène qu’il a jouée avec beaucoup de générosité. »
Pour Daniel Auteuil et Dimitri Doré qui n’avaient jamais joué avec lui, il développe :
« J’évite toujours de penser aux acteurs et actrices quand j’écris parce que, grâce à la distribution, on apporte au personnage un supplément d’âme tout à fait nouveau, hors programme. L’acteur fait toujours un pas de plus par rapport au scénario, et parfois même en contradiction avec le personnage écrit. Avoir Daniel Auteuil était une vraie chance…
Quant à Dimitri Doré , qui joue Ifus, le jeune mousse, je ne le connaissais pas. Je l’ai rencontré en phase de casting. Il a un tropisme incroyable pour les films burlesques et connaît mieux que nous toutes les anciennes comédies françaises dont il sait citer tous les seconds rôles… . C’est un comédien très prometteur. »
Il revient sur ses fidèles dont Sandrine Kiberlain :
« Il y a déjà longtemps que je lui avais parlé de ce projet. Je l’ai attendue un an. Elle a joué subtilement une Justine qui ne se laisse pas faire, qui mène la danse, tout en étant rieuse et légèrement déstabilisée »
Et son frère Denis Podalydès :
« Denis a su jouer presque à la de Funès le rôle d’un mesquin et d’un jaloux, mais qui se fragilise ensuite. Il n’a pas du tout envie de précipiter sa femme dans cette arnaque…. »
Il évoque à travers ses acteurs ses multiples postes, réalisateur et comédien, sans oublier son rôle de pilote de la péniche :
« Oui, il y avait des plans ou je portais les trois casquettes en même temps. Quand l’équipe me voyait arriver le matin dans cette tenue blanche éclatante, on m’appelait « Mon capitaine » et c’était joyeux comme pour une opérette. »
En contradiction avec le rythme lent de la croisière fluviale, Bruno Podalydès précise :
« Dans La Petite Vadrouille, en tous cas, il y avait le plaisir d’aller pied au plancher, de ne surtout pas s’embêter avec la fameuse justesse, la vraisemblance. C’était drôle d’y aller à fond, en appuyant sur les accents, tous ces trucs très enfantins, pousser le bouchon quoi ! J’avais envie que le film soit gai.
Sources Why not productions
- Radio France, aller à la page d'accueil
- France Inter
- France Bleu
- France Culture
- France Musique
- La Maison de la Radio et de la Musique
- L'entreprise Radio France
- Les Editions Radio France
- Personnalités
- Nous contacter
- Comment écouter Radio France
- Questions fréquentes (FAQ)
- La Médiatrice
- Votre avis sur le site
- Accessibilité : non-conforme
- Gestion des cookies
- Mentions légales
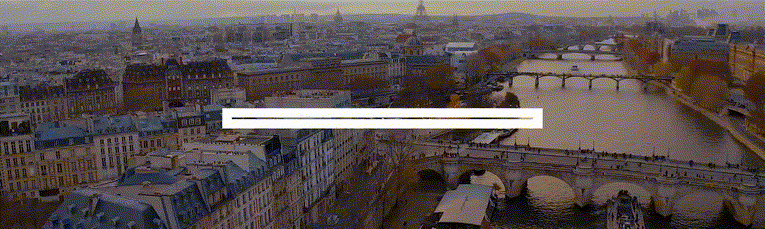
IMAGES
VIDEO
COMMENTS
Dans son Supplément au voyage de Bougainville, Denis Diderot met en scène deux protagonistes nommés A et B. B souhaite présenter un soi-disant supplément au récit de Bougainville remettant en question certains faits. Cinq chapitres développent cet argumentaire.
Résumé détaillé chapitre par chapitre de Supplément au voyage de Bougainville de Denis Diderot. CHAPITRE 1 - JUGEMENT DU VOYAGE DE BOUGAINVILLE. Deux personnages A et B attendent que le brouillard se dissipe pour pouvoir poursuivre leur voyage.
Résumé. Les protagonistes du dialogue de Diderot, A et B, discutent du Voyage autour du monde du navigateur français Louis-Antoine de Bougainville récemment paru (en 1771 ). B propose de parcourir un prétendu Supplément qui remet en question certaines prétendues évidences énoncées par Bougainville, premier Français ayant fait le tour du monde.
Supplément au voyage de Bougainville, de Denis Diderot, fait référence au voyage de l'explorateur Bougainville en Océanie. Ce texte soulève le problème du colonialisme et célèbre la vie sauvage par rapport à l'homme civilisé, ici dénigré.
Fiche de lecture sur Supplément au voyage de Bougainville, Denis Diderot : ️ résumé ️ personnages ️ citations ️ thèmes... par SchoolMouv ® N°1 pour apprendre & réviser.
Supplément au voyage de Bougainville de Diderot est un dialogue opposant deux façons de penser, de vivre. Les thèmes principaux sont le colonialisme et la vie sauvage. L'auteur compare l'homme civilisé orgueilleux et l'homme naturel libre. C'est quelques années après sa visite à Catherine II de Russie que Diderot écrit cet ouvrage. Il ...
Ce document propose un résumé clair et détaillé de Supplément au Voyage de Bougainville de Denis Diderot, dont voici un extrait :« Partie I : Jugement du voyage de BougainvilleEn attendant que le brouillard se lève pour pouvoir sortir, B lit le Voyage autour du monde de Bougainville, un récit que ce dernier a écrit après une grande ...
Supplément au voyage de Bougainville. Le Supplément se présente comme un dialogue sur le récit, publié par Bougainville, de son voyage autour du monde et de son séjour à Tahiti, surnommé la Nouvelle Cythère, car les amours y seraient libres. Le décor est exotique mais le propos de Diderot radical.
supplÉment au voyage de bougainville. Dialogue philosophique de Denis Diderot (1713-1784), dont le titre complet est: Supplément au Voyage de Bougainville, ou Dialogue entre A et B sur l'inconvénient d'attacher des idées morales à certaines actions physiques qui n'en comportent pas, publié par l'abbé Bourlet de Vauxcelles dans ...
Le Supplément au Voyage de Bougainville fait entendre plusieurs voix : les deux interlocuteurs, A et B, commentent, texte à l'appui, ce Voyage que B est en train de lire, et dont il prétend restituer l'intégralité, car les passages licencieux en auraient été supprimés.
Rédigé par Denis Diderot en 1772, le Supplément au Voyage de Bougainville est publié pour la première fois en 1796 à titre posthume dans le recueil Opuscules philosophiques et littéraires, la plupart posthumes ou inédites.
Supplément au voyage de Bougainville. Bougainville boucle le premier tour du monde français en 1769, et publie son journal de bord en 1771. Comme Montaigne deux siècles auparavant, les philosophes sont frappés par ce récit et Diderot ne tarde pas à réagir, en critiquant la société de son temps à partir des vertus supposées des Taïtiens.
Notre fiche de résumé sur Le Supplément au voyage de Bougainville de Diderot a été rédigée par un professeur de français. A propos du résumé. Pages. 2. Format. .pdf. Style. abordable et grand public. Rédacteur du résumé. Pierre Lanorde. Titre du livre résumé. Supplément au voyage de Bougainville.
Supplément au voyage de Bougainville Résumé. par Denis Diderot. Résumé. Deux personnages discutent : B - le porte-parole de l'auteur - rapporte avec enthousiasme à A les singularités du Voyage autour du monde, récit du navigateur français Louis Antoine de Bougainville.
Le Supplément au voyage de Bougainville est un dialogue (ou conte) philosophique écrit par Diderot et qui traite du voyage que le grand explorateur Bougainville avait fait en Océanie. Ici, Diderot aborde plusieurs sujets en rapport avec le colonialisme. Credit Photo : Unsplash Joao Silas.
Le Supplément au voyage de Bougainville s'inspire du voyage réel de l'explorateur Bougainville en Océanie et de son récit Voyage autour du monde, dans lequel est évoquée la colère du vieux tahitien.
Diderot, Supplément au voyage de Bougainville, 1772 Au départ de Bougainville, lorsque les habitants accouraient en foule sur le rivage, s'attachaient à ses vêtements, serraient ses camarades entre leurs bras, et pleuraient, ce vieillard s'avança d'un air sévère, et dit :
Bougainville, a contemporary of Diderot, was a French explorer whose 1771 book Voyage autour du monde ( A Voyage Around the World) provided an account of an expedition that took him to Argentina, Patagonia, Indonesia, and Tahiti.
Denis Diderot. Supplément au voyage de Bougainville. Colonisation. Le Supplément se présente comme un dialogue sur le récit, publié par Bougainville, de son voyage autour du monde et de son séjour à Tahiti.
Résumé. Voir tout. Qui, de l'Européen civilisé ou du Tahi-tien "sauvage", est le plus heureux ? Existe-t-il un modèle de société idéale ? Voilà quelques-unes des questions qui occupent A et B, nos protagonistes : ils dialoguent, débattent, comparent, et, ce faisant, s'ouvrent à l'altérité. Et ils ne sont pas les seuls.
A, qui n'a pas lu cet ouvrage interroge B sur la personnalité de Bougainville (« un homme curieux qui passe d'une vie sédentaire et de plaisirs au métier actif, pénible, usant et dissipé du voyageur ») et sur son voyage, ce qui permet à B de rappeler les grandes étapes de son périple.
Ce document propose un résumé clair et détaillé de Supplément au Voyage de Bougainville de Denis Diderot, dont voici un extrait :« Partie I : Jugement du voyage de BougainvilleEn attendant que le brouillard se lève pour pouvoir sortir, B lit le Voyage autour du monde de Bougainville, un récit que ce dernier a écrit après une grande expédition ma...
Dialogue philosophique de Denis Diderot (1713-1784), dont le titre complet est: Supplément au Voyage de Bougainville, ou Dialogue entre A et B sur l'inconvénient d'attacher des idées morales à certaines actions physiques qui n'en comportent pas, publié par l'abbé Bourlet de Vauxcelles dans Opuscules philosophiques et littéraires à Paris chez Che...
France Inter. La petite vadrouille, un film de Bruno Podalydès, sortie en salles le 5 juin 2024. Une croisière fluviale en famille, une arnaque collective…. « Les personnages sont loin d'être parfaits. Ils sont sympathiquement imparfaits, sans trop de souci moral ». Un partenariat France Inter.